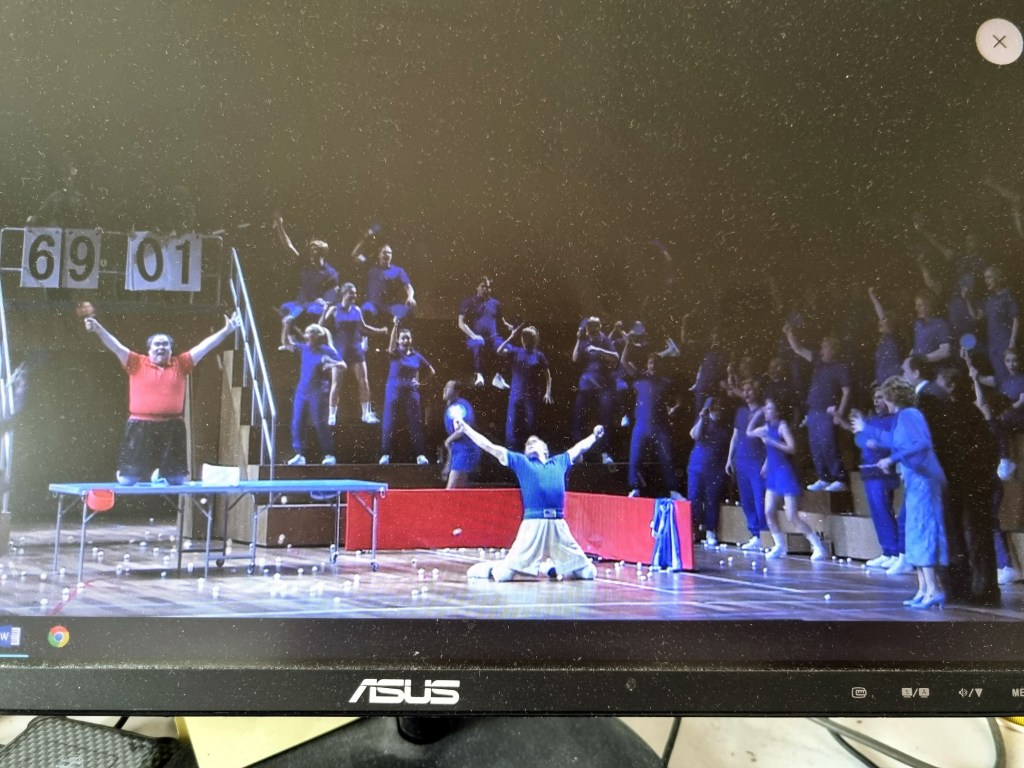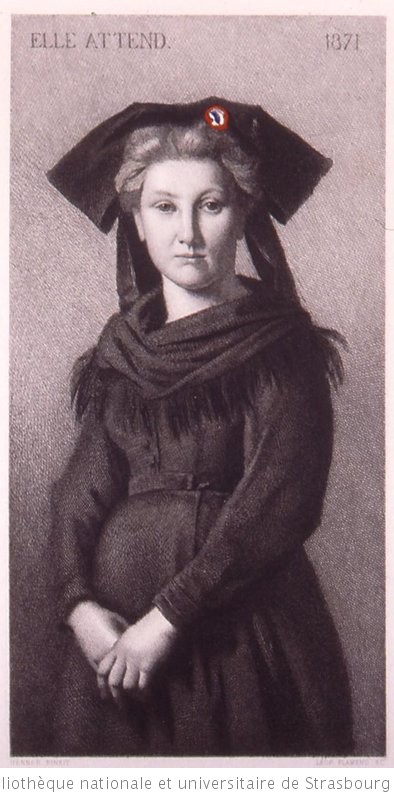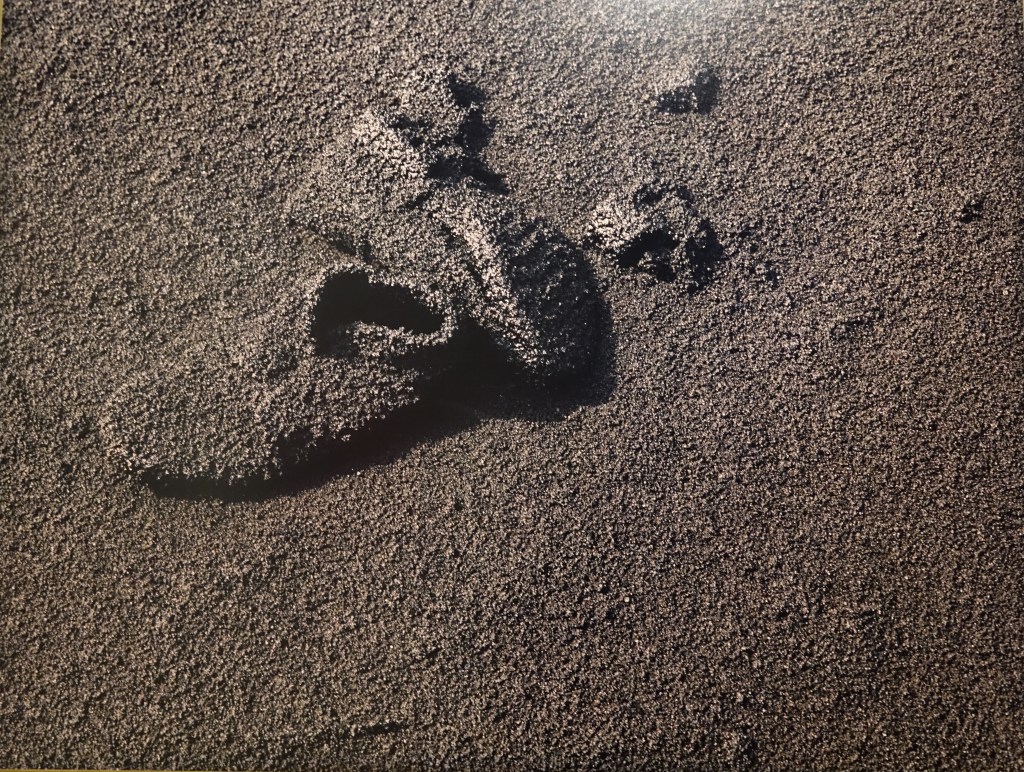Qu’on appelle ça stage ou académie, ce qui fait plus chic, peu importe ! Ce sont 6 jours de chant l’après-midi, et de concerts le soir. Les matinées, nous les utilisons comme bon nous semble. On peut se promener dans la ville, suivre les ruelles en forte pente, s’arrêter dans de minuscules gargotes, déjeuner pour 10 euros de raviolis chinois et d’une salade de concombres du Yunnan… Les prix sont tellement bas que les restaurants sont pris d’assaut par des étudiants aussi joyeux que peu argentés. On dirait que la ville ne se vide jamais de sa jeunesse.

Les faubourgs de Montpellier ont leur lot de personnes survivant de minimaux sociaux ou de quelques emplois hospitaliers, entassées dans des habitats insalubres, dans des cités où des gamins sans avenir font les idiots, mais après les dernières années passées à Paris, le centre paraît doux à vivre.
Les statistiques ont beau évoquer des vols et des « incivilités », l’impression de relations gentilles et insouciantes prédomine…

…et on revient la nuit sans se retourner.

Montpellier est une ville de fontaines, souvent majestueuses ; la plus célèbre est celle de la place de La Comédie, toute entourée des bâtiments merveilleusement kitsch du 19e siècle.

L’eau est précieuse dans ce territoire ingrat de l’Hérault où le Lez est exsangue quand il ne déborde pas, où les cailloux affleurent, où la végétation est rabougrie et grise. Aussi, les places de la ville ont toujours l’air nettoyées du jour, sentent le frais, et les brumisateurs des terrasses offrent un peu d’humidité aux passants.
J’ai l’impression d’une ville bâtie sur un tertre. Les rues dégringolent vers la partie basse, certaines tellement raides qu’on évite les chaussures glissantes pour ne pas déraper sur les pavés.
Il y a partout des palais anciens, ornés de portails sculptés, de ferronneries, de belles poignées.


Même dans les immeubles non restaurés, on trouve parfois un détail à aimer.

Et puis il y a la cathédrale défendue par des tours massives, incroyablement hautes et épaisses qu’on appelle des poivrières.

Le musée Fabre
Le musée Fabre est idéal. Il n’est pas trop fréquenté. Il a un fond classique étoffé et des collections importantes de Bazille, de Courbet et de Soulages. C’est l’occasion de s’arrêter devant des peintres que j’ai croisés par hasard lors d’expositions. Ainsi Georges-Daniel de Monfreid, le père de l’écrivain baroudeur qui a fait rêver les adolescents d’après-guerre. J’ai aimé son portrait de fillette lors de l’expo pastel d’Orsay et voici le portrait d’un ami, René Andreau. On connaît Monfreid en tant qu’ « ami fidèle de Gauguin ». Pour la deuxième fois, je m’enchante de ses couleurs, ici des rouges orientaux. Peut-être, l’attitude du modèle n’était-elle pas jugée assez virile ? Elle devient regardable en 2023.

Emile Friant est aussi un peintre bien oublié qui émerge peu à peu au hasard de balades dans les musées de province. Je me souviens d’une toile poignante intitulée La Toussaint, conservée par le musée de Nancy. Ici, ce sont des ados qui luttent et la scène dit de l’enfance quelque chose de fondamental qui réveille la nostalgie des spectateurs.

Chaque fois que je croise les toiles de Bazille, je pense « Comme il a bien su montrer ce garçon qui fait la sieste dans la chaleur, ce pays dans la lumière de l’été. Il faudrait que je prenne le temps de mieux le regarder. » Une fois de plus, ce sera pour la prochaine fois.

Mais voici l’orgueilleux Courbet de Bonjour monsieur Courbet, le peintre à la barbe pointue que son mécène salue respectueusement (au fond comme saluaient les donateurs médiévaux, mais il est vrai qu’il s’inclinaient devant Dieu et non devant l’art moderne).

Même sentiment des pouvoirs de la peinture dans ces Baigneuses que je détestais à vingt ans pour leur absence de grâce. Aujourd’hui, je suis fascinée par la monumentalité du corps de la femme nue.

Devant le petit tableau intitulé A Palavas un tel sentiment d’immensité qu’on pense aux vers de Baudelaire, son ami :
La mer est ton miroir tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame.
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer

J’avoue que cette fois, je m’ennuie tranquillement devant les Outrenoirs de Soulages, quitte à me laisser surprendre de temps en temps par les grands coups de pinceaux bleus traversant le noir de toiles plus anciennes :

La Theresienmesse de Haydn
Des leçons de piano de l’adolescence, Haydn m’avait laissé le souvenir de sonates dont j’avais envie de dire « pas mal, mais c’est du sous-Mozart » et voici que par la grâce d’un stage de chant choral, je découvre la puissance de synthèse de ce compositeur. Dans la Theresienmesse, on chante des mélodies expressives, ainsi le Qui Tollis qui appartient à son temps avec les effets dramatiques qui feront le succès des opéras de Mozart ou bien l’émouvant Et Incarnatus, (laissé hélas aux solistes, mais c’est le destin des choristes que de passer à côté des plus beaux airs). Pour se consoler, le chœur a à chanter des fugues baroques, et des danses sur des airs sacrés, dans une atmosphère de fête heureuse. Le Gloria est même jubilatoire ce qui atténue les effets grandioses soulignés à grands coups de trompette.
Pendant cinq jours, notre quarantaine de choristes s’est entraîné à articuler, à s’appuyer sur des consonnes, à écouter le pupitre voisin (« quand les ténors ont le thème, ils le chantent forte, mais juste après les ornements, ils doivent murmurer pour que le thème entonné par la voix suivante soit bien audible). Les conseils se ressemblent d’un chef à l’autre : attaquer avec un fort appui sur les consonnes avant même de chanter prononcer les KKK « mettez de l’air dans vos consonnes KKKHHH pour kyrie ; ne jamais prononcer à la française les voyelles « i, u, é », les remplacer par des « oe » qui arrondissent la voix ; écourter les notes tenues pour que les voix ne tourbillonnent pas dans les églises ; ne jamais ânonner note à note, chanter des lignes, chaque note portant jusqu’à la suivante. Les conseils sont les mêmes, mais Hugues Reiner est lui-même chanteur et il sait comment aider, par quel mouvement de la respiration, des bras, du torse, on peut parvenir à ce qu’il souhaite. Il n’hésite pas pour faire comprendre le « swing » de Haydn à ordonner « Allez-y. Dansez ! Chantez en dansant. » Le troupeau des choristes malhabiles exécute plutôt un piétinement sans grâce aucune, mais quand même se dit qu’il approche un peu le secret de cette musique.
Il nous a pris comme nous sommes : des gosiers de retraitées pour la plupart. Certes, capables de déchiffrer à peu près une partition, mais sans très belles voix et comme à l’habitude avec un vrai déficit de basses et ténors : Au fait ! Pourquoi donc, les femmes à la retraite se lancent-elles joyeusement dans de multiples activités, alors que la plupart des hommes s’abstiennent ?
Hugues Reiner a commencé par faire rire le groupe ; il l’a soudé par le rire. Il a tout de suite repéré quelques profils, l’inspectrice des impôts, l’infirmière psychiatrique, la directrice des ressources humaines, ce qui lui permet d’interpeler des personnes et de ne pas s’adresser à un groupe abstrait… Qui dira sa patience répétant pour la dixième fois qu’il veut entendre le « t » final de « et » prononcé à la latine sur le deuxième temps pour que tout le monde s’arrête simultanément et qui doit constater qu’une fois de plus un choriste a oublié la consigne. Parfois cependant enivré de sa propre gaîté, il raille, … il blesse. Le groupe consterné attend la fin de l’orage, sachant qu’il ne mord pas par malveillance, mais parce qu’il y a un concert à préparer.
Au bout de cinq jours, nous donnons avec engagement un concert « au chapeau ». Il y a du monde, mais l’église n’est pas pleine, malgré les gens partout en ville. La grande majorité est indifférente à ce qui n’est plus du tout son héritage. Serait-il possible que la musique de Haydn soit abandonnée ? J’ai le sentiment douloureux que cette perte est possible, que notre société risque d’oublier en silence la si forte expérience de cette musique fabriquée en commun.