Je mets rarement les pieds dans le quartier Vendôme où les grands joailliers comme Chopard et Bréguet ont leurs boutiques, quartier tellement inséparable de l’opulence capitaliste mondialisée, que je n’ai rien à faire là. Bertrand Dreyfuss, un ami historien récemment disparu à qui je dédie ce billet, m’y a pourtant amenée un jour, en me rappelant que ce lieu avait longtemps été associé aux Lumières et à la Révolution française, plus tard à la Commune qui avait fait abattre la colonne Vendôme, symbole du militarisme de Napoléon ;

Colonne Vendôme. Depuis un hall d’immeuble
le quartier peut rappeler aussi les chemins de traverse qu’empruntait Victor Hugo pour retrouver Léonie Biard.
Place Vendôme
L’architecte Jules Hardoin a conçu cette place carrée à angles coupés en 1699 à la demande de Louis XIV. Il avait imposé le grand goût classique aux futurs propriétaires des immeubles : les nouveaux bâtiments, aux façades édifiées avant même les immeubles pour s’assurer qu’elles seraient identiques sont imposants, tout en étant rythmés par des pilastres monumentaux et par les lucarnes du dernier étage. Le nom d’origine de Place des Conquêtes célébrait les exploits guerriers de Louis XIV. Mais dès le XVIIIe siècle, la dénomination actuelle s’imposa d’après le nom de l’Hôtel du duc de Vendôme, fils d’Henri IX et de Gabrielle d’Estrée.

Un voyage dans le passé révolutionnaire
Tandis que nous parcourions le quartier, Bertrand ravivait le souvenir de l’époque, invisible pour les passants pressés, où le quartier était le cœur de la révolution. En 1792, la place Vendôme fut rebaptisée place des Piques parce que les têtes coupées de deux gardes du roi y furent promenées au bout de piques. C’est aussi le nom dont fut baptisée la section des Piques, une des 48 sections qui avaient remplacé les anciens districts subordonnés à l’Etat et qui étaient devenus une instance politique majeure. 3 540 citoyens de toute condition participèrent à la Section des Piques. Robespierre, qui habitait alors tout près, chez le menuisier Duplay, au 398 rue Saint Honoré, en faisait partie. Bertrand m’avait montré la cour intérieure sur laquelle donnait la fenêtre de sa chambrette. « Il a habité là pendant trois ans », avait-il dit. Dans cette chambre minuscule, il n’y avait guère de place que pour un lit et sans doute une écritoire. La chambre d’un juste, qui vivait la vie modeste du peuple qu’il prétendait représenter ? Celle d’un ascète inquiétant, étranger aux aspirations normales des gens ? Le logis de Duplay est une des rares demeures des grands acteurs de 1789 qui subsiste. Les maisons de Danton, de Marat, de Saint-Just ont disparu. Du moins, le souvenir du premier subsiste dans ce bâtiment du Ministère de la Justice où il avait installé le gouvernement provisoire de la République au lendemain du 10 août.
Le club des Jacobins qui a joué le rôle de laboratoire politique n’est plus là non plus. Il se trouvait à l’emplacement de l’actuel Marché Saint-Honoré dans l’ancien couvent des Dominicains, désaffecté après la confiscation des biens du clergé en octobre 1789. Le club des Amis de la Constitution avait alors loué ce couvent et prit le nom de club des Jacobins (d’après l’autre nom donné aux Dominicains). Fermé un peu après la chute de Robespierre le 9 Thermidor, le club a été rasé et on a aménagé à sa place le Marché du 9 Thermidor. Aujourd’hui, la halle chic qui occupe l’emplacement a été rebaptisée Marché Saint-Honoré.

Le lieu où a siégé la Convention à partir de 1793 n’existe plus. C’était aux Tuileries, au niveau du 230-232 rue de Rivoli, dans la Salle du Manège qui a brûlé pendant la Commune, en 1871.
A la section des Piques, il y avait beaucoup d’anonymes et quelques célébrités. En septembre 1792 ; Sade en a été le secrétaire en 1792 et il y a lu son Discours aux mânes de Marat et de Le Pelletier, lors d’une cérémonie organisée en hommage aux « deux martyrs de la liberté ». Ce qui me touche, c’est que Sade ait coexisté avec Robespierre et peut-être discuté avec lui. Evidemment, ils étaient contemporains, engagés tous les deux ; et tous deux ont mis leur vie en jeu dans cette époque brûlante.
Plus de pierres, plus de murs et de porches, ni de salles. Restent des noms, rue Neuve-des-Petits-Champs, rues Sainte-Croix, de l’Égout, Neuve-des-Mathurins, de la Ferme, Thiroux, Caumartin, Trudaine, Boudreau, Basse-du-Rempart, des noms, et encore, ils mutent au gré des changements d’opinion. Oui ! Certains noms concentrent les émotions. Au lieu de de dire Place des Conquêtes, on a trouvé commode de dire place Vendôme, puis ce souvenir de l’ancien régime a paru insupportable et on a préféré place des Piques. La Restauration a ramené Vendôme. En 1871, les Communards ont abattu la colonne qui célébrait les « vainqueurs de la boucherie d’Austerlitz » et pour célébrer l’humanité, ils ont choisi Place Internationale. Avec le triomphe des Versaillais, retour de Vendôme et nous y sommes toujours.
« C’est un joli métier que tu exerces, Bertrand, avais-je dit à notre ami. Tes mots font revivre les morts. Ils ont ressuscité pour un moment une époque terrible qui a vu trembler les puissants. Moi, je n’ai pas ton sens de la résurrection. Dans le temps même où je t’écoute, je vois les vitrines qui me rappellent le vitrage du Grand Hôtel de Balbec contre lequel se pressent les gens ordinaires afin d’apercevoir la vie luxueuse des dîneurs.
» Proust qui comparait la salle à manger de l’hôtel à un aquarium et les riches à des monstres marins ajoutait “ (c’est) une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protègera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger”.
Proust qui comparait la salle à manger de l’hôtel à un aquarium et les riches à des monstres marins ajoutait “ (c’est) une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protègera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger”.
Léonie Biard et Victor Hugo : une pensée pour une femme vaillante
Aujourd’hui, je suis retournée place Vendôme, malgré le sentiment de vide que laisse la disparition de Bertrand Dreyfuss. J’ai marqué une halte au numéro 8 où le peintre Biard avait son atelier. On se souvient davantage de sa compagne Léonie d’Aunet Biard, née Thévenot d’Aunet que sa biographe désigne comme l’autre passion de Victor Hugo.


Quand le poète l’avait rencontrée vers 1841, Léonie était auréolée de gloire en raison de ses aventures dans le Grand Nord. Première femme à avoir traversé le cercle polaire arctique, elle était petite et fine, avec des cheveux clairs, un profil d’enluminure, une souplesse de valseuse.
Elle aimait raconter son voyage à bord de la corvette la Recherche. Le botaniste Paul Gaimard, chef de la Commission scientifique du Nord cherchait un peintre qui l’accompagne dans les régions nordiques et s’était adressée à Léonie pour qu’elle décide son compagnon, le peintre François Auguste Biard, à faire partie de l’expédition. Or, Léonie négocia son propre départ et obtint satisfaction contre la coutume de ne pas emmener de femme à bord des navires de l’État… En juin 1839, le couple s’était embarqué à Hammerfest en Norvège, suffisamment au nord pour qu’une femme soit présente à bord d’un navire de la marine royale sans qu’elle ait à se cacher. Léonie d’Aunet put donc visiter l’île du Spitzberg puis traverser la Laponie à cheval et en canot, avant de revenir vers Stockholm pour rentrer à Paris au début de 1840. Le voyage était éprouvant et dangereux. Les glaces manquèrent d’emprisonner la corvette et les hommes d’équipage s’interrogeaient sur les chances de survie d’une jeune femme « pâlotte, menue, maigrelette, avec des pieds comme des biscuits à la cuiller, et des mains à ne pas soulever un aviron (Voyage, p. 181) ». Comme dit un timonier, cette femme « avec sa mine mièvre de Parisienne, elle est frileuse comme une perruche du Canada ». Lorsque la corvette se dégage et que le groupe parcourt la Laponie, la nature est tout aussi hostile, imposant de traverser marais et cours d’eau à des voyageurs qui doivent se remettre immédiatement à marcher dans leurs vêtements trempés pour se réchauffer. Mais l’endurante Léonie a vu aussi des spectacles inouïs dont elle rendra compte dans son Voyage au Spitzberg, publié en 1854, comme sa description du palais des glaces, changeant continuellement d’aspect et décourageant les efforts du peintre comme ceux de l’écrivain.
Les glaces du pôle qu’aucune poussière n’a jamais souillées, aussi immaculées, aujourd’hui qu’au premier jour de la création, sont teintées des couleurs les plus vives ; on dirait des rochers de pierres précieuses : c’est l’éclat du diamant, les nuances éblouissantes du saphir et de l’émeraude confondues dans une substance inconnue et merveilleuse. Ces îles flottantes, sans cesse minées par la mer, changent de formes à chaque instant ; un mouvement brusque, la base devient sommet, une aiguille se transforme en un champignon, une colonne imite une immense table, une tour se change en escalier ; tout ceci si rapide et si inattendu qu’on songe malgré soi à quelque volonté surnaturelle présidant à ces transformations subites [III] Je voyais se heurter autour de moi des morceaux d’architecture de tous les styles et de tous les temps : clochers , colonnes, minarets, ogives, pyramides, tourrettes, coupoles, créneaux, volutes, arcades, frontons, assises colossales, sculptures délicates comme celles qui courent sur les menus piliers de nos cathédrales, tout était là confondu, mélangé dans un commun désastre. Cet ensemble étrange et merveilleux, la palette ne peut le reproduire, la description ne peut le faire comprendre (Voyages ; éd 1855, p. 173-4)
La chute du paragraphe évoque la commune entreprise qui unit François Biard et Léonie d’Aunet. De fait, à son retour le peintre réalisera plusieurs toiles qui représentent les paysages désolés du grand nord et qui font un peu penser à Caspar David Friedrich. Au musée de Dieppe, la présence humaine est réduite à quelques silhouettes fragiles perdues au milieu des vagues de glace, des formes fouettées par le vent qui se dressent menaçantes.

À Paris, Léonie d’Aunet, enceinte, avait épousé François Biard avant la naissance de leur fille. Au début tout allait bien. Le couple était à la mode. Dans les salons, dans les fêtes, tous les regards se focalisaient sur la première femme à avoir rejoint le Spitzberg et qui parlait si bien de son voyage. Les tableaux se vendaient.
Biard n’est pas apprécié des critiques contemporains. Pourtant le portrait de sa femme n’a rien de conventionnel. On peut penser que l’époux a su capter quelque chose du moi profond de Léonie. La jeune femme qui nous regarde gravement nous touche par-delà la mort.

Cependant François Biard commençait à être jaloux et à maltraiter Léonie. Des accès de colère de plus en plus fréquents à propos de tout et de rien. Elle avait parlé un peu trop longtemps avec un jeune homme, elle avait dansé deux fois avec un ami du couple, elle avait souri à ses plaisanteries. Elle ne voyait pas venir les crises. Elle ne savait pas les arrêter. Au début, elle n’avait rien dit; elle attendait que ça passe. Toutefois elle n’était pas une personne à supporter l’humiliation et à se laisser interdire tout contact avec les autres. C’est alors que Victor Hugo la rencontra.
J’avais trente-neuf ans quand je vis cette femme.
De son regard plein d’ombre il sortit une flamme,
Et je l’aimai
Léonie abandonna l’atelier de la place Vendôme, demanda la séparation de corps et de biens et s’engloutit dans le bonheur de son amour pour Hugo. Les lettres qui se succèdent donnent l’impression d’une tornade de sentiments. En voici deux :
Samedi – trois heures du matin. Je rentre.
J’ai ta lettre. Cette douce lettre, je l’avais lue aujourd’hui dans tes yeux. Que tu étais belle tantôt aux Tuileries sous ce ciel de printemps, sous ces arbres verts, avec ces lilas en fleurs au-dessus de ta tête. Toute cette nature semblait faire une fête autour de toi. Vois-tu, mon ange, les arbres et les fleurs te connaissent et te saluent. Tu es reine dans ce monde charmant des choses qui embaument et qui s’épanouissent comme tu es reine dans mon coeur.
Oui, j’avais lu dans tes yeux ravissants cette lettre exquise, délicate et tendre que je relis ce soir avec tant de bonheur, ce que ta plume écrit si bien, ton regard adorable le dit avec un charme qui m’enivre. Comme j’étais fier en te voyant si belle! Comme j’étais heureux en te voyant si tendre !
Voici une fleur que j’ai cueillie pour toi. Elle t’arrivera fanée, mais parfumée encore ; doux emblème de l’amour dans la vieillesse. Garde-la ; tu me la montreras dans trente ans. Dans trente ans tu seras belle encore, dans trente ans je serai encore amoureux. Nous nous aimerons, n’est-ce pas, mon ange, comme aujourd’hui, et nous remercierons Dieu à genoux.
Hélas ! Toute la journée de demain dimanche sans te voir ! Tu ne me seras rendue que lundi. Que vais-je faire d’ici là ? Penser à toi, t’aimer, t’envoyer mon coeur et mon âme. Oh! De ton côté sois à moi! A lundi ! — à toujours ! »
Victor Hugo
Et la réponse de Léonie
Cette Fleur me touche droit au coeur, tu es l’air que je respire, la lumière qui me donne la joie de vivre. Ce dimanche, en accompagnant ma chère sœur chez le coiffeur, tu me manquais tellement, tu hantais mes pensées. Le temps s’écoulait si lentement sans toi, j’attends avec impatience d’être entre tes bras, si doux, si chaud. Je garderais cette fleur pour le reste de ma vie, en pensent chaque jour à la chance que la vie ma donnée de te rencontrer.
Il faudrait citer tous les poèmes de Victor Hugo dont la rhétorique a moins vieilli et qui disent sans mièvrerie l’éblouissement de l’amour :
C’était la première soirée
Du mois d’avril
Je m’en souviens mon adorée
T’en souvient-il ?
Notre-Dame parmi les dômes
Des vieux faubourgs
Dressait comme deux grands fantômes
Ses grandes tours
La Seine découpant les ombres
En angles noirs
Faisait luire sous les ponts sombres
De clairs miroirs
Mais François Biard fait suivre sa femme afin de démontrer son infidélité et d’éviter de payer une pension pour ses deux enfants. Le 3 ou le 4 juillet 1845 (la date est incertaine), accompagné d’un commissaire de police, François Biard fait irruption dans une chambre meublée du passage Saint-Roch pour faire constater le flagrant délit d’adultère.
 Il découvre que l’amant est Victor Hugo, lequel Victor Hugo sort de sa poche sa carte de Pair de France. Il n’est pas inquiété en raison de son immunité parlementaire. Si la loi épargne le pair de France, elle s’acharne sur la femme.
Il découvre que l’amant est Victor Hugo, lequel Victor Hugo sort de sa poche sa carte de Pair de France. Il n’est pas inquiété en raison de son immunité parlementaire. Si la loi épargne le pair de France, elle s’acharne sur la femme.
Aujourd’hui, le passage Saint-Roch est tranquille. Un clochard y a trouvé refuge. Sur le mur de l’église quelqu’un a tracé une inscription optimiste.

L’avenir de Léonie est plus sombre. Elle est enfermée deux mois et demi à Saint-Lazare, prison des femmes prostituées (aujourd’hui la médiathèque Françoise Sagan a remplacé la prison). Il faut l’intervention de la duchesse d’Orléans, sœur du roi, pour que le mari se laisse acheter et accepte en échange de commandes officielles que la peine de l’épouse infidèle soit commuée. Elle passe encore quatre mois au couvent des Augustines. Livrée aux bonnes sœurs, la pute devient une pécheresse qu’il faut ramener au Seigneur. Bien sûr, elle perd la garde de ses enfants, et Biard n’est plus tenu de l’aider. On peut voir dans la Galerie de Minéralogie du Museum des scènes de chasse au Grand Nord qui sont le prix de la délivrance de sa femme. Elles sont médiocres et menteuses. Le peintre représente des scènes de chasse alors que le récit de voyage de son épouse dit explicitement que les rennes avaient déserté le Spitzberg. Une jeune femme blonde s’occupe d’un chien. Est-ce que le peintre a voulu représenter Léonie ? On sait qu’il lui laissera en fin de compte élever ses enfants…

 Victor Hugo s’était réfugié chez sa maîtresse officielle, Juliette Drouet. A-t-il versé des larmes pour Léonie ou s’est-il surtout préoccupé que Juliette Drouet, ne sache rien ? Il a en tout cas cherché avec succès à empêcher que son nom soit divulgué dans la presse.
Victor Hugo s’était réfugié chez sa maîtresse officielle, Juliette Drouet. A-t-il versé des larmes pour Léonie ou s’est-il surtout préoccupé que Juliette Drouet, ne sache rien ? Il a en tout cas cherché avec succès à empêcher que son nom soit divulgué dans la presse.
Aujourd’hui, le pouvoir patriarcal est en miettes. L’adultère n’est plus un crime ; les femmes partagent la puissance parentale avec les hommes, on a peine à imaginer la férocité de la société du XIXe siècle. Certaines femmes ont pu s’épanouir dans la société du XVIIIe siècle à la fin de l’Ancien Régime. Au XIXe, ne reste que la domination. Malheur à celles qui s’obstinent à vivre pour elles-mêmes.
Réfugiée chez une tante, Léonie d’Aunet reprend pourtant ses relations avec Victor Hugo jusqu’au départ en exil de l’écrivain après le coup d’Etat du futur Napoléon III. Adèle Hugo, la femme légitime, se rapproche d’elle, l’aide comme elle peut. La rupture intervient quand Léonie propose de rejoindre Victor Hugo en Belgique et que le poète envoie Adèle lui expliquer qu’il ne dérangera pas l’équilibre de sa vie pour elle. Léonie ne le reverra jamais, même si la famille Hugo l’aide assez régulièrement à élever les deux enfants. La vie n’est plus remplie d’amour et de beaux projets. Pour gagner de l’argent, elle écrit : d’abord quelques chroniques de mode dans le journal L’Evènement sous le nom de Thérèse de Blaru,.puis dans la Revue de Paris (qui publie des textes des textes de tous les grands auteurs de l’époque ; ensuite, grâce à la protection d’Adèle Hugo, chez Hachette où elle publie, en 1854, le récit de son voyage en Laponie qui connaîtra de nombreuses rééditions et ensuite quelques romans (Un mariage en province, Une vengeance, L’Héritage du Marquis d’Elvigny), quelques contes édifiants (Étiennette, Silvère, Le Secret) et une pièce de théâtre, Jane Osborn, représentée avec succès sur le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il s’agit d’œuvres qui évoquent souvent l’inégalité des rapports entre les sexes, mais on y cherche en vain le mélange d’enjouement et de sens de la description grandiose qui fait le charme du Voyage d’une femme au Spitzberg.
Les premiers biographes de Victor Hugo ont eu des mots très durs pour Léonie d’Aunet ; ils pardonnaient à l’humble Juliette Drouet puisqu’Adèle avait trompé son mari avec Sainte-Beuve et qu’elle lui refusait tout rapport sexuel. Mais Léonie d’Aunet, rebelle, sensuelle, cultivée, ne pouvait être qu’une créature mauvaise puisqu’elle avait détourné le génie de ses devoirs. Ils appelaient provocation le fait qu’elle ait voulu jouir de la vie sans se soucier de ce qui était convenable pour une femme. Pour que justice lui soit rendue, il a fallu attendre le livre de Françoise Lapeyre parue en 2005, Léonie d’Aunet, Paris, JC Lattès.
D’elle, je garde l’image, non pas triomphante, mais émouvante, d’une femme qui a su se reconstruire de façon indépendante, élever les enfants que le père lui avait finalement laissés, se professionnaliser et dont la malchance a été de naître dans une époque si féroce pour les femmes libres.
Quelques références
Bertrand Dreyfuss a écrit pour la collection Parigramme de précieux guides qui invitent à la promenade érudite dans le 6e, le 5e, et le 20e arrondissement
Pour la Révolution Française, on consultera l’incontournable http://www.parisrevolutionnaire.com
Daniel Claustre, « Voyager, aimer, écrire: la vie d’une femme du XIXeme siecle (Léonie d’ Aunet, 1820-1879) », file:///C:/Users/Windows/Downloads/207847-285814-1-PB%20(2).pdf
Françoise Lapeyre, 2005, Léonie d’Aunet, Paris, JC Lattès.
On peut voir des toiles de François Biard L’Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848, 1848-1849, huile sur toile, au château de Versailles ; Magdalena Bay. Vue prise de la presqu’île des Tombeaux, au nord du Spitzberg. Effet d’aurore boréale, 1841, huile sur toile, au Musée du Louvre.






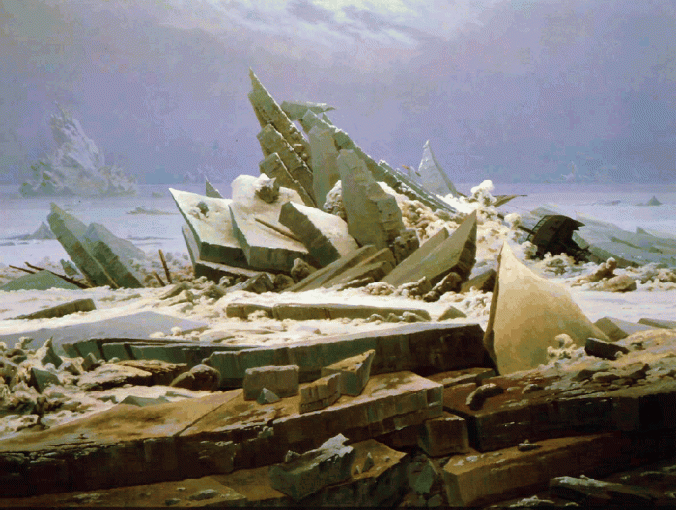
















 Proust qui comparait la salle à manger de l’hôtel à un aquarium et les riches à des monstres marins ajoutait “ (c’est) une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protègera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger”.
Proust qui comparait la salle à manger de l’hôtel à un aquarium et les riches à des monstres marins ajoutait “ (c’est) une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protègera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger”.



 Il découvre que l’amant est Victor Hugo, lequel Victor Hugo sort de sa poche sa carte de Pair de France. Il n’est pas inquiété en raison de son immunité parlementaire. Si la loi épargne le pair de France, elle s’acharne sur la femme.
Il découvre que l’amant est Victor Hugo, lequel Victor Hugo sort de sa poche sa carte de Pair de France. Il n’est pas inquiété en raison de son immunité parlementaire. Si la loi épargne le pair de France, elle s’acharne sur la femme.






 Nous avons envie d’oublier la période coloniale, les massacres qui ont accompagné les conquêtes, la domination méprisante qui s’en est suivi, mais le siècle dernier est aussi un temps qui a appris aux Français la diversité des cultures humaines, le charme d’architectures inconnues, la beauté des gens d’ailleurs.
Nous avons envie d’oublier la période coloniale, les massacres qui ont accompagné les conquêtes, la domination méprisante qui s’en est suivi, mais le siècle dernier est aussi un temps qui a appris aux Français la diversité des cultures humaines, le charme d’architectures inconnues, la beauté des gens d’ailleurs.









![La_grande_querelle_du_ménage_[...]_btv1b6938434b](https://passagedutemps.com/wp-content/uploads/2017/02/la_grande_querelle_du_mc3a9nage_-_btv1b6938434b.jpeg?w=676)


