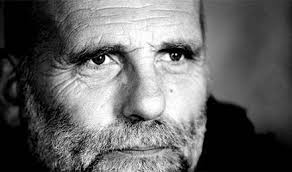Sur les trottoirs
Les trottoirs de Paris ne sont pas accueillants. Coincés entre les potelets anti-stationnement et les tables des cafés qui débordent pour accueillir les fumeurs en terrasses, les flâneurs sont tout à coup frôlés par des vélos, ou bien ce sont des trottinettes, des planches de skate, des rollers. Combien de mètres faut-il pour que s’arrête un jeune qui fait du 8m/seconde ? Je n’en sais rien, mais ne suis pas rassurée.

Les enfants, par définition réputés charmants ne sont pas les moins problématiques. Lancés comme des projectiles, arriveront-ils à freiner si des septuagénaires en promenade-écolo croisent leur trajectoire ?

 A présent, se rajoutent les Segway (ce sont, disent les sites marchands, des gyropodes monoplaces électriques). L’autre jour, j’ai croisé une petite troupe de pilotes de gyroscopes, sagement regroupés autour d’un moniteur… Leurs utilisateurs se sentent à la pointe du progrès. Dommage qu’ils roulent en silence et qu’ils nous fassent sursauter quand ils nous doublent sans qu’on les ait entendu approcher !
A présent, se rajoutent les Segway (ce sont, disent les sites marchands, des gyropodes monoplaces électriques). L’autre jour, j’ai croisé une petite troupe de pilotes de gyroscopes, sagement regroupés autour d’un moniteur… Leurs utilisateurs se sentent à la pointe du progrès. Dommage qu’ils roulent en silence et qu’ils nous fassent sursauter quand ils nous doublent sans qu’on les ait entendu approcher !

Tous ces engins à roues, qui circulent de plus en plus fréquemment sur les trottoirs et sur les places que les édiles déclarent « espaces mixtes », donnent des sueurs froides aux piétons.
Les pistes cyclables installées un peu partout sur les trottoirs ne font qu’ajouter au sentiment d’insécurité. Je ne sais pas comment les aveugles s’en tirent, mais les distraits ont du souci à se faire. Hier deux promeneurs devisaient tranquillement ; ils n’ont pas prêté attention aux coups de sonnette frénétiques d’un cycliste, d’autant plus furieux qu’il était dans son bon droit (ce qui n’est pas toujours le cas). Le cycliste s’est arrêté le temps d’insulter copieusement les distraits qui n’avaient pas respecté les bandes blanches matérialisant la piste cyclable. Il faudrait garder les yeux rivés au sol !

Sur la chaussée, c’est presque aussi difficile. Après quelques années d’éducation, un Français savait comment traverser. Quand la rue était à sens unique, il tournait le cou du côté où passent les voitures et s’engageait. Aujourd’hui, dans la rue qui double la place de la Nation, les voitures soumises au sens unique viennent par la droite. Hélas ! La piste cyclable arrive par la gauche. Une ou deux fois par mois, un cycliste furieux freine brusquement devant une vieille dame éperdue en hurlant « Vous pourriez faire attention ! ».
« Si on était conscients dit la caissière du Franprix, on s’aventurerait dehors après avoir rédigé son testament. »
La cohabitation entre urbains ne va plus de soi. Chacun se sent la victime du désordre actuel : les personnes âgées trouvent les rouleurs très égoïstes. Les cyclistes en veulent aux automobilistes et aux piétons insouciants ; les automobilistes s’emportent contre les cyclistes imprudents qui se faufilent n’importe comment.
Ceci dit, je ne sais pas si « c’était mieux avant ». Il y a longtemps, moi aussi, j’ai roulé au milieu des piétons. C’était sur la Promenade des Anglais. Nice était une ville de retraités en ce temps-là. Nous faisions du patin à roulettes le long de la mer et nous adorions frôler les vieux ou les forcer à s’arrêter pour nous voir passer, ivres de notre vitesse, fiers de la souplesse de nos mouvements. Nous nous sentions si beaux, si gais, si vivants à côté des vieillards effarés.
Les rollers sur la chaussée
D’ailleurs les rollers paraissent bien sympathiques quand ils randonnent sur la chaussée. Chaque vendredi vers 21 h 45, ils se rassemblent sur la place Raoul-Dautry, en face de la gare Montparnasse ! De là, ils partent, débutants et experts, seuls, entre amis, en famille, traînant des landaus ou virevoltant d’un bord à l’autre de la chaussée pour un grand tour de Paris.

Pousse-pousse, tuk-tuk, vélos-taxis
Sur la chaussée, le problème principal reste les embouteillages. Coincés dans une longue file d’automobiles et de bus, les conducteurs trompent leur ennui en klaxonnant et regardent en râlant les piétons qui coupent le flot des voitures immobilisées.
Comme le touriste a horreur d’être coincé dans une file de voitures, qu’il lui faut des journées excitantes durant le temps où il voyage, il emprunte les tuk-tuk qui sont implantés en ville depuis une dizaine d’années.
On les appelle pousse-pousse lorsqu’ils sont tractés par des hommes et tuk-tuk, lorsqu’ils sont motorisés, vélo-taxis, ou encore cyclo-taxis, en abrégé, cyclos. Les touristes qui semblent plébisciter ce nouveau moyen de transport ont peut-être l’impression de vivre une expérience exotique, qui plus est écologique, puisque ces véhicules ne polluent pas. Pendant qu’ils regardent la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, l’Opéra et la Concorde, les passagers se promènent au milieu des palais et des fontaines de Paris, et effectuent en surimpression un voyage vers l’Asie.
Au début, j’étais humiliée par le spectacle de ces pousse-pousse qui me paraissaient exploiter de façon si visible le travail physique des hommes. J’avais l’impression de voir transgresser le principe d’égalité qui aurait dû interdire de ressentir le moindre plaisir à être mollement installés sur des coussins pendant qu’un homme ou une femme traînait deux-cent kilos de passagers.

Depuis, j’ai appris que les tuk-tuk fonctionnent en principe avec des moteurs électriques auxiliaires. Une amie se plaint d’ailleurs de conducteurs qui ont trouvé le moyen de pénétrer dans le garage de son immeuble pour venir recharger en catimini leur batterie, soit que les bornes de recharge soient en nombre insuffisant, soit qu’ils cherchent à échapper aux factures d’électricité.
Côté vélo-taxis, on insiste sur la liberté que procure cette activité. Dans un reportage du Point, daté de juillet 2014, « Alex, jeune diplômé de 25 ans, circule quotidiennement dans la capitale depuis le mois de janvier 2014. À l’époque, il voit dans le cyclo-taxi un moyen de patienter le temps de trouver un emploi. Même s’il envisage de raccrocher un jour, il apprécie son aspect lucratif (jusqu’à 3 000 euros les très bons mois, dont il faut néanmoins déduire les impôts et les cotisations liées au statut autoentrepreneur) et la totale liberté dont il dispose pour organiser ses journées de travail ». (http://www.lepoint.fr/economie/cyclo-taxi-emploi-d-avenir-18-07-2014-1847121_28.php).
Evidemment une fois ôtées les cotisations, il reste moins de la moitié. Alex ne toucherait guère plus qu’un petit boulot payé au SMIC (Le montant mensuel brut sur la base de 35 heures du Smic 2018 est de 1 498,47 euros), mais il se dit qu’il est un autoentrepreneur, libre de choisir ses horaires.
Quelques sociétés se partagent le marché : Allo Tuk Tur est la plus implantée à Paris www.paris-by-tuktuk.com. On peut réserver par téléphone +33 (0) 6 23 33 43 64
bookatuktuk@gmail.com ou se rendre 73 place de la Concorde – Cet été, pour 40 euros, trois personnes pouvaient faire un tour d’une demi-heure. Cyclopolitain (Service de réservation PARIS : (+33 0) 1 46 33 25 19 ) est implanté dans toute la France et fête ses 3. 5 millions de passagers transportés depuis sa fondation en 2003. L’idée a depuis été reprise par d’autres sociétés comme Trip Up (Tricycles Urbains de Proximité) ou Yellow Pedicab (Rue de la Cité au Parking SAEMES).
En tout cas, les touristes ne se rendent pas compte des guerres que déclenchent ces nouveaux modes de travail. Les taxis se sont mobilisés contre les nouveaux-venus, comme ils le font pour Uber et ils ont obtenu une législation restrictive. L’exploitant d’un tuk-tuk doit être titulaire d’un permis moto de catégorie A en cours de validité, d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique, d’une carte professionnelle délivrée par le département, cette carte professionnelle étant elle-même délivrée sous condition d’un casier judiciaire vierge et d’une absence d’annulation ou suspension du permis de conduire, d’une visite médicale obligatoire chaque année.
Le conflit principal porte sur les emplacements. Benjamin Maarek, fondateur d’Allo Tuktuk. (www.liberation.fr/societe/2014/08/21/paris-tique-sur-le-tuktuk_1084429) dénonçait en 2014 l’inégalité de traitement : « Le droit à l’emplacement, c’est le droit de travailler. On veut être mis au même rang que les bus touristiques à deux étages, les bateaux mouches, les petits trains ». En décembre 2016, la législation était toujours dans un entre-deux bizarre. Le Conseil municipal et départemental de Paris ont entendu ce mois-là le représentant du Préfet de police décrire « une activité répressive qui se poursuivra dans les jours et les semaines à venir pour faire en sorte que chacun respecte la réglementation applicable, par un P.V. de 35 euros, ce qui n’est pas, à ce stade, très onéreux, et par des opérations C.O.D.A.F. également menées de manière à vérifier la légalité de ces opérations en matière de droit au travail, de droit au séjour et vis-à-vis des déclarations fiscales ». L’Etat ne choisit pas vraiment entre laisser l’activité se poursuivre avec des amendes qui ne sont pas dissuasives et pourchasser les contrevenants. (Séance des 12, 13 et 14 décembre 2016 152). Je n’ai pas trouvé de nouveau texte.
A ces conflits s’ajoutent des luttes pour la conquête des territoires. On dit que les jeunes Français stationnent près de Notre-Dame. Bulgares ou Roumains (je ne sais pas les distinguer) seraient plutôt vers la Tour Eiffel et vers Iéna où l’on croise souvent des femmes. En tout cas, ils et elles sont nombreux à haranguer les touristes et chacun se plaint du comportement des autres nationalités.







 On pouvait croire, disaient les commentateurs, qu’on se trouvait en Inde sans quitter Paris. (Il aurait mieux valu dire au Pakistan. En fait, dans les années 1970, des Pakistanais, puis des Sri-Lankais et des Mauriciens qui avaient renoncé à rejoindre une Angleterre de plus en plus difficile à atteindre, s’étaient arrêtés à Paris où ils sont désormais concentrés vers La Chapelle. Certains se sont établis dans ce passage où se succèdent restaurants, épicerie, coiffeurs, onglerie…) Cependant, tous ces commerçants pratiquent aujourd’hui des prix plus élevés que ceux de leurs compatriotes de La Chapelle, pour une nourriture qui tient du fast food. L’épicerie qui vend des patates douces, du manioc, des bouquets de coriandre, des épices en tout genre, de l’encens, du pain à nan… est elle aussi plus chère que les boutiques discrètes de la rue du faubourg.
On pouvait croire, disaient les commentateurs, qu’on se trouvait en Inde sans quitter Paris. (Il aurait mieux valu dire au Pakistan. En fait, dans les années 1970, des Pakistanais, puis des Sri-Lankais et des Mauriciens qui avaient renoncé à rejoindre une Angleterre de plus en plus difficile à atteindre, s’étaient arrêtés à Paris où ils sont désormais concentrés vers La Chapelle. Certains se sont établis dans ce passage où se succèdent restaurants, épicerie, coiffeurs, onglerie…) Cependant, tous ces commerçants pratiquent aujourd’hui des prix plus élevés que ceux de leurs compatriotes de La Chapelle, pour une nourriture qui tient du fast food. L’épicerie qui vend des patates douces, du manioc, des bouquets de coriandre, des épices en tout genre, de l’encens, du pain à nan… est elle aussi plus chère que les boutiques discrètes de la rue du faubourg.
 Toujours, elle a rivalisé avec sa voisine, la galerie Colbert. A présent que cette dernière abrite des institutions universitaires, la guerre a pris fin. Le seul commerce de Colbert est le restaurant du Grand Colbert à l’entrée. Ce jour là, trois enfants jouaient derrière la vitrine à saluer les passants pour tromper l’ennui du trop long déjeuner des parents.
Toujours, elle a rivalisé avec sa voisine, la galerie Colbert. A présent que cette dernière abrite des institutions universitaires, la guerre a pris fin. Le seul commerce de Colbert est le restaurant du Grand Colbert à l’entrée. Ce jour là, trois enfants jouaient derrière la vitrine à saluer les passants pour tromper l’ennui du trop long déjeuner des parents.

 Même si aujourd’hui, les lieux sont consacrés à de calmes études universitaires, ils gardent le souvenir de la grande bourgeoisie. On devine la voix assurée des banquiers, des commerçants enrichis, des entrepreneurs qui ont fait poser sur le mur cet emblème de leur pouvoir. Avec du travail, et de l’organisation sociale (et en accumulant du capital) la ruche humaine produirait l’abondance tout en enrichissant ceux qui spéculaient sur l’immobilier.
Même si aujourd’hui, les lieux sont consacrés à de calmes études universitaires, ils gardent le souvenir de la grande bourgeoisie. On devine la voix assurée des banquiers, des commerçants enrichis, des entrepreneurs qui ont fait poser sur le mur cet emblème de leur pouvoir. Avec du travail, et de l’organisation sociale (et en accumulant du capital) la ruche humaine produirait l’abondance tout en enrichissant ceux qui spéculaient sur l’immobilier.